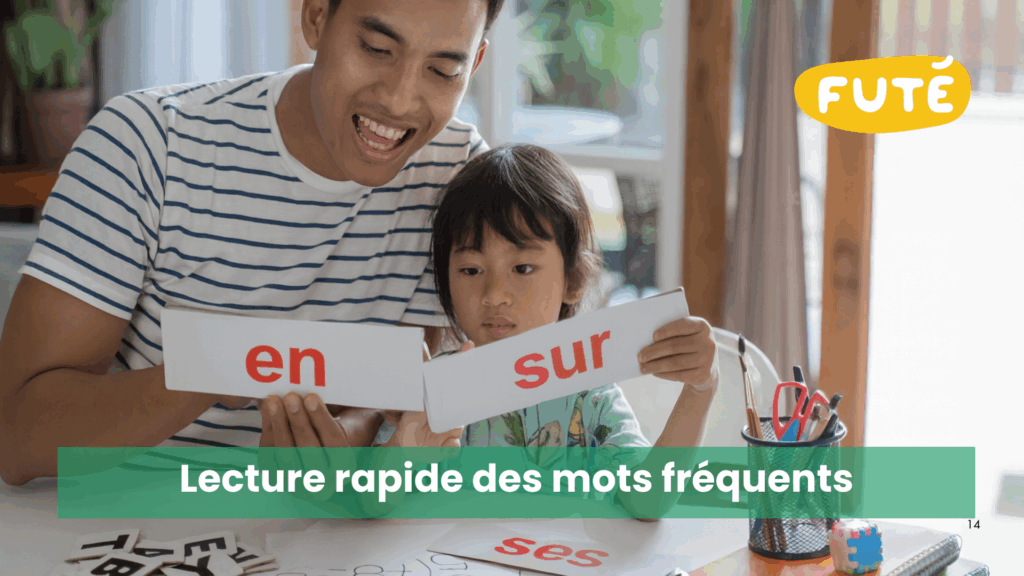Mots-étiquettes : Attention aux raccourcis en début d’apprentissage de la lecture
Par Geneviève Cusson, Orthopédagogue M.A., Blogue Futé, novembre 2025
On rêve tous du moment où nos élèves lisent avec aisance, sans s’arrêter à chaque mot comme si le texte était truffé de panneaux « arrêt ». Mais la lecture, on le sait, ne s’attrape pas par magie : elle s’enseigne, patiemment, explicitement et stratégiquement. Or, l’usage des mots-étiquettes au mauvais moment peut se transformer en véritable brouillard pédagogique.
Les vraies bases : décoder avant de reconnaître
La fluidité repose toujours sur trois composantes : la vitesse (combien de mots sont lus correctement par minute), l’exactitude (est-ce que l’élève lit réellement ce qui est écrit) et la prosodie (l’art de ne pas lire comme un robot qui manque d’huile). Et ces trois composantes exigent toutes une même fondation : la capacité à décoder les mots.
En début de scolarité, ce décodage se développe grâce à la conscience phonémique, à la connaissance des correspondances lettres-sons, aux régularités orthographiques et aux stratégies d’identification de mots. Bref, l’élève apprend à lire en comprenant comment ça fonctionne, et non pas en mémorisant des silhouettes de mots comme s’il préparait un concours de logos.
Quand les mots-étiquettes arrivent trop tôt : bienvenue dans le royaume de la devinette
Plusieurs cahiers d’exercices suggèrent l’utilisation de mots-étiquettes en début de scolarité tels que poupée ou bureau. Le problème, c’est que l’enfant n’a pas encore les connaissances nécessaires pour identifier le son des lettres, fusionner ces sons ou comprendre la structure du mot. On se retrouve alors à lui enseigner une stratégie de contournement : la devinette !
La devinette peut rendre service dans certains contextes — lorsque l’élève comprend la phrase, maîtrise partiellement quelques correspondances et tente de déduire un mot nouveau. C’est une stratégie compensatoire acceptable… à petite dose. Mais lorsqu’un élève utilise la devinette comme stratégie principale, tout se dérègle : il repère seulement une ou deux lettres, saute des mots, invente des bouts de phrases, ignore les finales et produit parfois des interprétations tellement étranges qu’on en vient à se demander : « Mais, où est-il allé chercher ça ? »
Ce phénomène n’est pas anodin : il réapparait souvent au 3e cycle et au secondaire, lorsque la charge cognitive augmente et que les limites de la devinette deviennent impossibles à compenser. Les élèves lisent plus vite qu’ils ne décodent, et les erreurs se multiplient.
Une anecdote mémorable : l’affaire beaucoup
Voici une anecdote vécue qui illustre parfaitement le problème…
Dès le début de la 1re année, en octobre de leur 1re année, les enfants devaient « globaliser » le mot beaucoup. Sauf que, ils n’avaient pas vu le b, ni le eau, ni le c (avec ses deux sons), ni le ou. Et cerise sur le sundae : la seule lettre qu’ils connaissaient — le p — est muette ! Autrement dit, ils n’avaient aucune connaissance sur laquelle s’appuyer pour décoder le mot. J’ai alors demandé à l’enseignante comment elle expliquait comment lire beaucoup à ses élèves. Elle a répondu : « C’est simple, je leur dis que c’est le mot le plus long. »
Ce qui reviendrait à dire qu’à chaque fois qu’un élève rencontre un mot long, il devrait se dire : « Ah, ça doit être beaucoup. » On imagine facilement les phrases absurdes qui pourraient en découler : Le chien beaucoup dans la cour.
Non seulement le mot est complexe, mais il n’est même pas assez fréquent en début de 1re année pour justifier une reconnaissance globale. Bref, un parfait exemple de mot-étiquette à ne surtout pas introduire trop tôt.
Alors, quand les mots-étiquettes sont-ils réellement utiles ?
L’utilisation des mots-étiquettes devient pertinente lorsque les élèves les rencontrent tellement souvent qu’ils finissent par les reconnaître sans effort. Les mots courts et fréquents comme un, le, à en sont de bons exemples. Apprendre tôt à reconnaitre globalement ceux-ci permet au cerveau de se concentrer sur ce qui exige plus de travail : le décodage de mots plus longs et moins fréquents. C’est là que les mots-étiquettes jouent vraiment leur rôle : alléger la charge cognitive et soutenir la fluidité.
Mais pour les mots complexes, rares ou difficiles à décoder, les mots-étiquettes ne sont pas des raccourcis… ce sont des pièges. C’est en enseignant le décodage de manière explicite et progressive que l’élève développe, naturellement, la capacité de reconnaître les mots globalement — pas l’inverse. Autrement, il devra recourir à de bonnes stratégies d’identification des mots.
En résumé : la fluidité vient du décodage, pas de la devinette
Un bon lecteur est d’abord un bon décodeur. Les mots-étiquettes sont utiles, oui, mais uniquement lorsqu’ils respectent la logique de l’apprentissage : des mots courts, fréquents, utiles, qui déchargent et n’ajoutent pas de confusion. La fluidité ne se construit pas par magie, mais bien pierre après pierre.
Et c’est justement là que toute la force d’un enseignement explicite prend son sens : offrir aux élèves une vraie compétence, durable, plutôt qu’un réflexe de conjecture qui finira, tôt ou tard, par leur jouer des tours.
Source : https://eduscol.education.fr/

À propos de Geneviève Cusson
Orthopédagogue M.A. et directrice générale chez Futé
Une véritable passionnée de pédagogie et d’orthopédagogie! En fondant Futé, cette orthopédagogue d’expérience veut partager sa passion, son expertise et ses connaissances pour rehausser le niveau de littératie et augmenter la réussite scolaire.
Rejoins la communauté Futé !

Téléphone
Courriel
Heures d'ouverture
Lundi au vendredi de 9h à 17h
Adresse
Val-Morin, Laurentides, Qc J0T 2R0
Inscription à l'infolettre
En t'inscrivant, tu consens à ce que Futé communique avec toi par courriel.